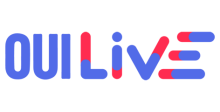Ça ressemblait à quoi le départ d’une Transat Jacques Vabre en 1995 ?
L’univers n’était pas du tout le même. On débarquait dans un port de commerce vide, mais à l’époque, j’avais tellement soif de bateau et de navigation que je m’en fichais ! Et puis je naviguais avec Paulo (Vatine) sur Région Haute Normandie. C’était un personnage et une sommité locale, le p’tit gars des bas quartiers qui avait réussi. Il avait gagné la précédente édition et se trouvait au sommet de sa carrière… On était porté par cette reconnaissance. Sa petite troupe se retrouvait au bistrot à côté de la Société des Régates du Havre. C’était beaucoup plus intimiste. La chaleur humaine compensait le dénuement et le côté industriel du coin…
A l’époque, tu étais passé assez facilement du Figaro à l’ORMA qui était la classe reine. Ce sont des enchaînements plus difficiles aujourd’hui …
Je sortais de quatre années de Figaro c’est vrai, mais surtout du creuset de Port La Forêt. C’était les débuts de CDK où on avait construit le 60 pieds Hitachi, la saga des Formule 40*, j’avais aussi couru la Whitbread sur Côte d’or et le Tour de l’Europe sur RMO avec Laurent Bourgnon.
Mais c’était une autre façon de faire à l’époque. On vivait dans un univers. Conception, construction, navigation, tout était très imbriqué autour de quelques personnes et j’ai eu la chance de tâter de la matière, de comprendre les efforts qui passent dans une structure. Les logiciels 3D n’existaient pas encore. Les dessins se faisaient sur le coin de la nappe, avec des architectes comme Vincent Lauriot Prévost et Marc Van Peteghem qui étaient très présents physiquement autour de nous à l’époque des Formule 40. Tout était très intense, un peu brouillon mais intense. Si tu t’accrochais à l’époque, il y avait de la place. On faisait la fête mais peut-être finalement plus d’heures de travail cumulées qu’aujourd’hui parce qu’il n’y avait aucune séparation entre la vie privée et le bateau. Tout faisait partie d’un tout. Le déclic pour nous, ça a été le Centre d’entraînement de Port La Forêt (Pôle Finistère Course au large aujourd’hui NDR). On était des chiens fous, on avait tous les ingrédients de la recette, mais le Centre nous a donné un cadre.
Carthagène, a été ton premier port d’arrivée de la Route du café. Tu en conserves quel souvenir ?
C’était une magnifique arrivée. On l’emporte finalement avec Paulo, bien routés par Jean-Yves Bernot qui avait fait un super boulot. La bagarre avait été intense jusqu’à la fin devant Francis (Joyon) et Jacques (Vincent) avec une porte à l’arrivée sur les Antilles et on descendait en match race le long de la côte vénézuélienne au milieu des troncs d’arbre, des bouts de mangrove. C’était exotique ! En voyant nos bateaux, les pêcheurs locaux s’écriaient Waterworld, Waterworld ** car le film était déjà sorti en Amérique. C’était la beauté et la limite de notre sport que d’exporter des modèles comme la course avec de tels décalages de civilisation.
Tu as connu toutes les destinations d’arrivée à travers tes neuf participations. As-tu un attachement particulier à l’une d’elles ?
Toutes, sauf la Martinique, puisque j’ai du renoncer à courir la dernière édition avec Yannick (Bestaven) pour des problèmes de dos. Donc, c’est bien que je revienne ! J’ai beaucoup aimé le Brésil, mais j’ai un souvenir précis de Carthagène. C’était un peu limite sur le plan de la sécurité mais Jacques Vabre nous avait organisé en 95 une visite formidable des plantations de café. J’ai pu découvrir par exemple le travail d’un gouteur de café ! Le gars a une longue table devant lui avec plein de tasses alignées sur des séries d’environ 1 mètre. Il boit une gorgée de chacune, recrache et donne une note sur un curseur. Ça va très vite et le gars enchaîne ! Une chose est sûre, c’est qu’à cette époque, on faisait autre chose à l’arrivée d’une course que juste s’amarrer dans une marina. Et avec le recul, je trouve que c’est un aspect qui n’a pas été très réussi en course au large, je ne parle pas spécifiquement de Route du café : L’intégration et les interactions avec les gens du milieu dans lequel on débarque.
On se fait des amis sur une transat en double ?
Je ne sais pas… Je dirais plutôt que ça peut renforcer une amitié, comme ça a été le cas avec Ellen (Mac Arthur) en 2005. C’est quand même un pari le double à chaque fois. Je pense qu’aujourd’hui, le niveau professionnel ayant grimpé, la recherche de performance canalise bien la cohabitation. Mais il peut y avoir encore de belles engueulades : entre le stress, la bagarre des égos, la casse, tu peux vite partir dans les embrouilles. Avec le recul, j’ai eu plus de tensions avec mes équipiers sur des transats AG2R que sur les Transat Jacques Vabre, c’est sans doute lié à l’exigence de la monotypie.
Et puis, en course Open sur les gros bateaux, il y a généralement un porteur de projet et un invité. Là, je navigue sur le bateau de Guirec et il n’y a aucune ambiguïté. Il faudrait vraiment qu’on soit cons pour s’engueuler ! Il va quand même falloir ranger notre orgueil dans la poche car son bateau n’a quasiment pas évolué depuis que l’ai rendu en 2010. Il n’a pas suivi les évolutions de jauge et le jeu de voiles date un peu…
En 1995, vous étiez 11 tandems au départ. 95 bateaux s’élanceront dimanche prochain. Qu’est-ce que ça t’évoque ?
C’est indéniablement un succès. Il y a eu les pionniers, Eric Tabarly en tête, puis les Terlain, Fauconnier, Poupon,… j’ai connu un peu la fin de cette époque. Ma génération est arrivée, on a damé le terrain et la suivante a commencé à glisser sur l’autoroute. Mais, évidemment tout ça me questionne. Dans les années 90, nous n’avions aucune idée des limites planétaires. On baignait dans le composite que l’on vénérait. On voulait aller de l’avant et se comparer aux autres sports professionnels, on rêvait de F1 ! De fait, l’intelligence collective du milieu est devenue fantastique. Les bateaux volent. Une écurie de course bien structurée aujourd’hui, ça a quand même de l’allure et une somme de compétences incroyable en structure, en hydro, en aéro, même en intelligence artificielle. Ce qui nous manque, c’est l’ingénierie environnementale.
Car la course au large n’est pas un sport comme les autres. On n’a pas les mêmes valeurs, on ne raconte pas la même histoire et à mon sens nous n’avons pas assez cultivé ce joyau. On reste aveuglé par la performance.
Qu’est-ce qu’il faut faire ? Moins de bateaux, des bateaux plus lents ?!
En 2010, nous avions fait le bilan carbone de notre IMOCA. Comparé avec celui de 11th Hour (IMOCA vainqueur de The Ocean Race 2022-2023 NDR), l’empreinte a été multipliée par deux. C’est difficile à faire passer mais qu’on le veuille ou non, la courbe de performance est parallèle à celle d’émission de CO2. Pour sauter plus haut à la perche, il faut mettre plus d’énergie, tu n’en sors pas… Et je pense qu’aujourd’hui, cette quête de vitesse est has been. Le dernier Vendée Globe a été un énorme succès et pourtant il s’est couru aux vitesses de 2008. Ça n’a pas gêné le sport.
Je pense que demain, on peut continuer à construire des bateaux, mais il faut les rendre plus utiles. Il faut brasser les idées. Pourquoi ne pas exiger un volume de coque qui permette de faire en même temps de la course et du fret maritime ? Ce qui pourrait aussi donner une deuxième vie à un bateau plus facilement. Plus on attend, plus le changement sera douloureux car ça créée des scissions dans le milieu et aucun porteur de projet n’a envie d’abandonner le sien. Certaines voix individuelles commencent à se faire entendre et j’espère qu’elles serviront d’aiguillon.
* Formule 40 : Multicoques de régate de 40 pieds utilisés sur des formats de Grand-Prix qui s’est développée dans les années 80 et a servi de laboratoire pour les futurs trimarans ORMA.
** Waterworld : Dystopie réalisée par Kevin Reynolds en 1995 qui met en scène Kevin Kostner sur un trimaran réalisé à l’époque chez Jeanneau Techniques Avancées dans les moules du Groupe Pierre 1er de Florence Arthaud.